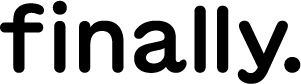L'esthétique a changé
Cet article prône l’appréciation des surfaces, de l’expérience sensorielle et physique. Il s’oppose à une attitude qui comprend le social comme un système de normes rationnel et intentionnel et réduit la perception sensorielle au traitement de l’information.
En 2000, le phénomène d’une nouvelle consommation durable a été décrit pour la première fois dans des livres tels que « The Cultural Creative: How 50 Million Are Changing The World » (Ray 2001). Sous l’acronyme LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), des sociologues et futurologues ont examiné un nouveau groupe qui alignait son mode de vie sur les principes de durabilité. Cette nouvelle base de consommateurs se distingue des anciens écolos des années 70 et 80 moins par une nouvelle attitude que par un nouveau style de vie esthétisé. « Nous sommes les nouveaux écolos », affirme le manifeste LOHAS en 2007. « Notre consommation est systématiquement écologique et équitable, sans sacrifier la modernité. Contrairement aux « anciens écologistes », nous sommes favorables à la technologie et axés sur le plaisir. Nous […] profitons durablement. Nous sommes conscients des conséquences de notre consommation et essayons de les maintenir aussi basses que possible. Nous nous intéressons à la santé, à la spiritualité, à la durabilité et à l’écologie. Allez au yoga ou au tai-chi, buvez du thé vert ou du Bionade. « Nous sommes souvent végétariens » (karmakonsum.de 2007). Ces valeurs ne sont pas fondamentalement éloignées de celles des « anciens écologistes » ; ils se sont « simplement » tournés vers les nouvelles technologies et adaptés à notre mode de vie axé sur le plaisir.
Quand on entend cette auto-description 15 ans plus tard, on ne peut s’empêcher de penser immédiatement aux manifestations esthétiques de ces LOHAS. On y voit des smoothies verts, du carton marron, des pulls en laine tricotés à la main et des photos d'une coexistence idyllique en harmonie avec la nature. Des termes comme la pleine conscience sont esthétisés sur des tableaux noirs avec des labels de qualité manuscrits comme « fait maison » ou « conçu par la nature ». On imagine des slogans comme « less is more », qui trouvaient leur place sur les piliers publicitaires mobiles de l’époque – les sacs en jute 100% bio – et « eco-fashion », qui est toujours équitable et se présente sous une nouvelle forme comme slow ou green fashion . Cette utilisation de codes esthétiques existants et passés nous a permis de réfléchir aux « anciennes valeurs » d’une manière « nouvelle ». Les concepts abstraits de durabilité redeviennent désirables grâce à des auras de produits ascétiques et orientées vers la nature. L'esthétisation contemporaine de l'éco-look, la mise en œuvre d'un « style de vie durable », permet aux citoyens consommateurs (non éduqués en matière de durabilité) de s'identifier progressivement au vélo et aux thermos et donc aussi à une nouvelle attitude critique envers l'environnement et le consommateur. Boltanski et Chiapello (2003) considèrent l’appropriation capitaliste engendrée par les pratiques esthétiques non seulement comme un instrument de greenwashing, mais ils croient également que la nouvelle consommation morale peut renouveler l’esprit capitaliste vers une plus grande responsabilité (Teigeler 2015). Et cela semble s’être produit, compte tenu du nombre croissant d’électeurs verts et des manifestations engagées des jeunes en faveur du climat. La conscience a changé et un petit groupe de consommateurs de muesli a réussi, avec l’aide de processus d’esthétisation, à sensibiliser une masse plus large à l’urgence de la politique environnementale (Zukunftsinstitut 2007), en créant des approches non seulement rationnelles mais aussi sensuellement perceptibles qui se glissent désormais dans l’agenda économique et politique contrôlé rationnellement.
C’est pourquoi je pose la question suivante : y a-t-il quelqu’un dans nos rangs qui croit que ce n’est qu’à travers des informations non esthétisées, des faits purs et des approches purement cognitives que nous pourrions parler avec autant de véhémence du changement climatique et d’un mode de vie durable aujourd’hui ? Pensons-nous vraiment que des définitions abstraites telles que « la durabilité est un principe d’action pour l’utilisation des ressources , dans lequel la satisfaction à long terme des besoins doit être assurée en préservant la capacité de régénération naturelle des systèmes impliqués (en particulier les êtres vivants et les écosystèmes ) » (Wikipedia 2019) ont fait de nous des citoyens consommateurs plus réfléchis ? Les choses, y compris leur apparence esthétique, sont des compléments ainsi que des alternatives à l’expression linguistique ; comme ceux-ci, ils déterminent à la fois la proximité et la distance. Cette proximité ou cette distance affecte non seulement notre socialité, mais nous permet ou nous empêche également d’acquérir de nouvelles approches sur les grands enjeux sociopolitiques.
Ce texte plaide donc pour que l’on considère également la sémiotique des choses qui n’ont pas encore subi de processus d’esthétisation, car à travers elles, nous pouvons déterminer quels objectifs et quelles visions du monde morales et éthiques une société (post-)capitaliste axée sur la performance poursuit. Le laid, le non-esthétique, est donc tout aussi instructif que le beau. Il donne un aperçu des valeurs collectives. Mais que se passe-t-il lorsque le non-esthétique ou le désesthétisé reste caché parce qu’il ne semble pas apte à être rendu « anti-esthétiquement » productif ? Ensuite, selon ma thèse, la laideur peut nous empêcher d’affronter des problèmes majeurs comme la maladie, la vieillesse et la mort dans notre vie quotidienne car elle rend l’identification et la proximité impossibles. Cela peut avoir pour conséquence que des questions sociales pertinentes sur l’avenir ne soient pas abordées ou qu’elles ne reçoivent des réponses que de manière très unilatérale et monosyllabique.
Parce que lorsque nous regardons la maladie et la mort, ce que nous avons décrit ci-dessus se réalise. Je me demande donc quelles images nous viennent à l’esprit lorsque nous pensons à des termes comme besoin de soins et fin de vie. Des mains ridées et en prière ou des mains faibles et plâtrées, des gants en latex, des lits d'infirmières en placage de bois imitation, des chemises d'infirmières à motifs, des tuyaux en caoutchouc transparents et une mer de couleurs telles que le chrome, le gris acier, le bleu désinfectant, le blanc de la blouse de laboratoire et le vert chirurgical peuvent apparaître devant notre œil intérieur. Des objets comme ceux-ci, avec leurs surfaces et leurs symbolismes, sont d’une part liés à une connaissance corporelle habituelle de la maladie, de la souffrance et de l’inquiétude de la perte d’autonomie, mais d’autre part, ils représentent également l’anonymat et le processus de standardisation de la médecine économisée, qui nous transforme de plus en plus en un corps déindividualisé qui est traité efficacement dans des usines de santé. On pourrait aussi dire, de manière malveillante, que ces esthétiques sont adéquates dans un sens pervers parce qu’elles « vendent » la maladie et la mortalité ou « l’incapacité » d’une manière laide. Si l’on considère les images lugubres qui symbolisent le besoin de soins, il est facile de supposer que la répression sociale et la tabouisation sont en partie responsables de ces images. J’examine ce mutisme sociétal et individuel. Une question qui me taraude : quelle influence une culture matérielle absente ou désesthétisée a-t-elle sur notre rapport à la maladie et à la mort ? L’autre question qui suit est spéculative : si nous reconnaissions le pouvoir de l’esthétique et l’exploitions, comme l’ont fait les LOHAS il y a quelques années, « être mortel et malade » et « être écolo » deviendraient-ils à nouveau plus acceptables socialement ? Un petit groupe international de « penseurs positifs de la mort » est actuellement en train d’initier ces processus. Personnellement, je suppose que cela ne sera pas possible sans une « refonte des mondes de la mort ». Car, que cela nous plaise ou non, c’est dans une large mesure l’esthétique des choses qui agit comme le « ciment social » et maintient notre monde ensemble.
Littérature:
Boltanski, L., Chiapello, E. (2003) : Le nouvel esprit du capitalisme. Maison d'édition UVK. Constance
Le Manifeste LOHAS de KarmaKonsum (2007) : Nous vivons LOHAS – les modes de vie sains et durables. Récupéré le 15 juillet 2014 sur https://www.karmakonsum.de/lohas_-_lifestyle-of-health-and-sustainability/
Teigeler, M. (2015) : Greemarketing. Dans : Mair, J., Stetter, B. (éd.) : Moralphobia, un glossaire Zeitgeist de la pleine conscience aux cigarettes. Hambourg : Gudberg Verlag.
Zukunftsinstitut GmbH (2007) : Groupe cible LOHAS. Kelkheim
Note de bas de page : Cet extrait de texte est tiré en partie et sous une forme légèrement modifiée de la contribution au livre « A Plea for an Aesthetic Future of Design » de Bitten Stetter, publiée dans la publication « Not at Your Service: Manifestos for Design » éditée par Hansuli Matter, Björn Franke et publiée à Zurich en 2020.